Madame Frédérique Carre est l'infirmière chef d'unité du service d'anesthésie.


Madame Frédérique Carre est l'infirmière chef d'unité du service d'anesthésie.

Madame Nadine Jacqmin est attachée de la Direction des soins, en charge de l'enseignement.

Découvrez cette première table ronde relative au dépistage, au diagnostic et à l'annonce du cancer du sein.
À l'occasion d'Octobre rose, le Groupe sein du CHL Kriibszentrum propose un programme de cinq tables rondes thématiques destinées aux femmes touchées par le cancer du sein, aux professionnels de santé, mais aussi à toutes les femmes qui souhaitent s'informer sur le dépistage et la prise en charge du cancer du sein.
Retrouvez également ces tables rondes sur le Blog du Groupe Sein CHL
Table ronde 1 : Dépistage, diagnostic et annonce
Table ronde 2 : Traitements
Table ronde 3: Témoignages de patientes
Table ronde 4: Soins de support et suivi post-oncologique
Table ronde 5: Partenaires aux côtés des patientes

Au Luxembourg, environ 4 AVC surviennent par jour. Si l’AVC est une maladie grave, il est d’autant plus important de savoir le reconnaître et d’agir rapidement et de façon adaptée.
A l'occasion de la journée mondiale de l'AVC le vendredi 29 octobre, l’équipe pluridisciplinaire de la Neurologie du CHL, en co-animation avec l’association Blëtz, organisera une journée de sensibilisation autour des sujets suivants:
CHL CENTRE › HALL D’ENTRÉE › 09H00-15H00
L’importance de reconnaître les symptômes et d’agir vite.
Lors de cette journée, entre 09h00 et 12h00 et entre 13h00 et 16h00, nos neurologues se rendent disponibles pour que vous puissiez bénéficier d’une échographie des vaisseaux du cou.
Pour cela, il est nécessaire de s’inscrire par le biais de l’association Blëtz au numéro : 621 88 00 88

Au Luxembourg, environ 4 AVC surviennent par jour. Si l’AVC est une maladie grave, il est d’autant plus important de savoir le reconnaître et d’agir rapidement et de façon adaptée.
A l'occasion de la journée mondiale de l'AVC le vendredi 29 octobre, l’équipe pluridisciplinaire de la Neurologie du CHL, en co-animation avec l’association Blëtz, organisera une journée de sensibilisation autour des sujets suivants:
CHL CENTRE › HALL D’ENTRÉE › 09H00-15H00
L’importance de reconnaître les symptômes et d’agir vite.
Lors de cette journée, entre 09h00 et 12h00 et entre 13h00 et 16h00, nos neurologues se rendent disponibles pour que vous puissiez bénéficier d’une échographie des vaisseaux du cou.
Pour cela, il est nécessaire de s’inscrire par le biais de l’association Blëtz au numéro : 621 88 00 88

Les maladies cardiovasculaires sont la cause principale de décès au Luxembourg. L’une des causes possibles de ces maladies est l’hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol dans le sang). Elle reste souvent longtemps non détectée et donc non traitée. Le premier symptôme est souvent une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
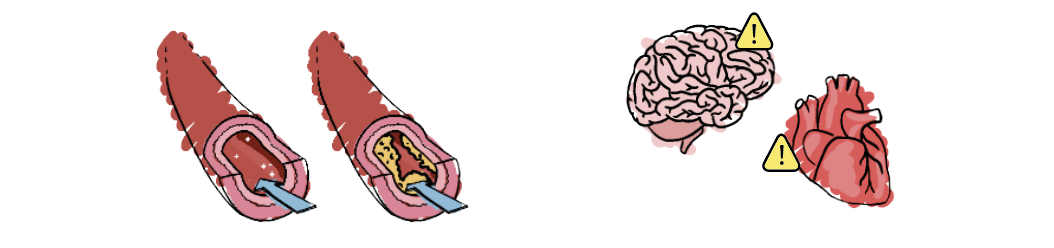
L’hypercholestérolémie familiale (FH) touche 1 personne sur 250 et est une maladie héréditaire (les enfants d’une personne atteinte de FH ont un risque de 50% d’être atteints). 9 patients sur 10 ne savent pas qu’ils sont atteints d’une FH.

La détection et le traitement précoces peuvent sauver des vies !
L’hypercholesterolémie peut être diagnostiquée à travers une analyse de quelques gouttes de sang.
Nous avons développé une étude pour voir si nous pouvons identifier les personnes souffrant d’hypercholestérolémie familiale et sont donc à risque accru de maladies cardiovasculaires.
L’idée est d’offrir une analyse du bilan lipidique à tous les enfants scolarisés dans les écoles primaires au Luxembourg. Nous allons commencer par les écoles primaires de la Ville de Luxembourg.
En collaboration avec la médecine scolaire de la Ville de Luxembourg, ce dépistage sera offert lors de l’examen médical scolaire et il sera effectué par une équipe de recherche du DECCP (endocrinologie et diabétologie pédiatrique au CHL).



Dr Marianne Becker :
Dr Carine de Beaufort :
Secrétariat :

Les maladies cardiovasculaires sont la cause principale de décès au Luxembourg. L’une des causes possibles de ces maladies est l’hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol dans le sang). Elle reste souvent longtemps non détectée et donc non traitée. Le premier symptôme est souvent une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
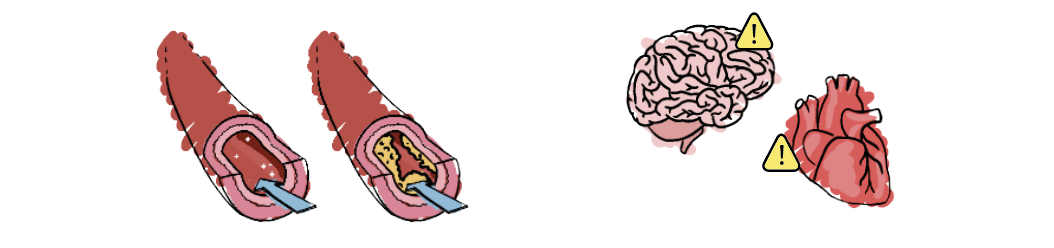
L’hypercholestérolémie familiale (FH) touche 1 personne sur 250 et est une maladie héréditaire (les enfants d’une personne atteinte de FH ont un risque de 50% d’être atteints). 9 patients sur 10 ne savent pas qu’ils sont atteints d’une FH.

La détection et le traitement précoces peuvent sauver des vies !
L’hypercholesterolémie peut être diagnostiquée à travers une analyse de quelques gouttes de sang.
Nous avons développé une étude pour voir si nous pouvons identifier les personnes souffrant d’hypercholestérolémie familiale et sont donc à risque accru de maladies cardiovasculaires.
L’idée est d’offrir une analyse du bilan lipidique à tous les enfants scolarisés dans les écoles primaires au Luxembourg. Nous allons commencer par les écoles primaires de la Ville de Luxembourg.
En collaboration avec la médecine scolaire de la Ville de Luxembourg, ce dépistage sera offert lors de l’examen médical scolaire et il sera effectué par une équipe de recherche du DECCP (endocrinologie et diabétologie pédiatrique au CHL).


Le Ministère de la Santé

Dr Marianne Becker :
Dr Carine de Beaufort :
Secrétariat :


À l'occasion d'Octobre rose, le Groupe sein du CHL Kriibszentrum propose un programme de cinq tables rondes thématiques destinées aux femmes touchées par le cancer du sein, aux professionnels de santé, mais aussi à toutes les femmes qui souhaitent s'informer sur le dépistage et la prise en charge du cancer du sein.
Pendant tout le mois, différents sujets permettront ainsi de faire le point sur le dépistage ainsi que sur la prise en charge, du diagnostic jusqu'au suivi post-traitement à long terme. Une large place sera également donnée aux témoignages très personnels de patientes ayant eu un cancer du sein et à nos partenaires engagées aux côtés de nos patientes et de leurs proches.
Ces tables rondes seront diffusées sur la page Facebook et sur le site internet du CHL à partir du mercredi 06 octobre:
Table ronde 1 : Dépistage, diagnostic et annonce
Table ronde 2 : Traitements
Table ronde 3: Témoignages de patientes
Table ronde 4: Soins de support et suivi post-oncologique
Table ronde 5: Partenaires aux côtés des patientes